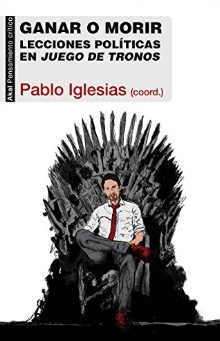Jusqu’où ira la baisse du prix du pétrole ? Les paris sont ouverts chez les financiers, alors que chaque jour est marqué par une nouvelle chute des cours. Lundi 5 janvier, le WTI (West Texas Interdemiate), le pétrole qui sert de référence aux États-Unis, est tombé en dessous des 50 dollars le baril. Trois jours plus tard, le Brent, pétrole de référence en Europe, passait à son tour ce seuil symbolique. Depuis, les cours poursuivent leur chute. Lundi 12 janvier, le WTI cotait 46,50 dollars et le Brent était à 47,63 dollars le baril. En six mois, le prix du pétrole a perdu 55 % de sa valeur. Il n’a jamais été aussi bas depuis 2009, au moment de la crise financière.
Les analystes et les experts n’avaient rien vu venir. Pendant quatre ans, le prix du pétrole a fait preuve d’une étonnante stabilité dans un monde en plein remue-ménage : il est resté invariablement au-dessus de 100 dollars le baril, atteignant le sommet de 128 dollars en juillet 2012. Pris de court, tous s’interrogent sur la suite. Faut-il écouter les prévisions du ministre saoudien du pétrole, Ali al-Naimi, qui annonce que les prix du pétrole pourraient tomber à 40, 30 voire 20 dollars ? Ou s’en tenir aux positions rassurantes d’un analyste de Standard & Poor’s qui, comme de nombreux autres dans les milieux financiers, prédit que les marchés vont se reprendre, et que les cours du Brent et WTI devraient se stabiliser respectivement autour de 70 et 65 dollars dans l’année. La banque Goldman Sachs , qui jusqu'à présent pronostiquait des prix élevés sur le pétrole, vient de radicalement changer sa position. Lunid 12 janvier, elle a publié une nouvelle étude annonçant un prix du baril en-dessous des 40 dollars pendant au moins la première partie de l'année.
Ce retournement est un événement majeur pour l’économie mondiale. Pour l’agence internationale de l’énergie (AIE), le monde pétrolier est entré dans une nouvelle ère. Certains économistes évoquent un contrechoc pétrolier, qui serait l’inverse de celui de 1973. La chute des cours pétroliers devrait, selon eux, apporter un deuxième souffle à l’économie mondiale, qui ne s’est toujours pas remise de la crise de 2008, et relancer la croissance en redonnant des marges aux entreprises et du pouvoir d’achat aux ménages, comme cela s’est produit en 1985 et en 1998. Les ménages américains auraient déjà économisé 14 milliards de dollars au dernier semestre, en raison de la baisse des prix de l’essence.
Le FMI prévoit qu’une baisse prolongée des prix du pétrole pourrait apporter entre 0,3 et 0,7 % de croissance supplémentaire à l’économie mondiale en 2015. Le gouverneur de la banque d’Angleterre, Mark Carney, vante déjà les effets « positifs » de la baisse de l’or noir. L’Insee s’inscrit dans le même scénario. Selon ses premières estimations, le PIB français devrait croître de 0,7 % au cours du premier semestre 2015, grâce à l’effet conjugué de la baisse des prix du pétrole, de la chute de l’euro et du redémarrage des échanges mondiaux. L’Élysée et le gouvernement s’accrochent à ces prévisions, espérant que la chute « providentielle » du pétrole va leur redonner enfin les marges de manœuvre qu’ils cherchent depuis 2012. Dans un entretien aux Échos, le ministre de l’économie, Emmanuel Macron, parle « d’une donne nouvelle ». 2015, selon lui, devrait être « une année de renaissance pour l’Europe et un tournant pour la France ».
Mais sommes-nous encore dans le même monde que celui de la fin du XXe siècle ? Les bienfaits d’un contrechoc pétrolier sont-ils aussi automatiques que certains l’anticipent ? Des économistes s’interrogent sur les risques déflationnistes que pourrait avoir la chute du pétrole dans l’économie européenne déjà aux prises avec la stagnation. D’autres se demandent si le rôle de la finance dans les marchés pétroliers, le poids des interconnexions dans une économie désormais mondialisée ne sont pas sous-estimés, avec le risque que la finance envoie une nouvelle fois l’économie mondiale dans le décor. Décryptage de quelques questions qui risquent de peser tout au long de 2015.
Pourquoi les prix du pétrole baissent
Depuis plus de quatre ans, les prix du pétrole étaient invariablement accrochés au-dessus des 100 dollars le baril. Brusquement, la chute s’est enclenchée en juillet 2014. Un curieux mois où tout s’entremêle : les espoirs de reprise en Europe s’évanouissent à ce moment-là, les signes de ralentissement deviennent manifestes en Chine, en dépit de statistiques faites sur mesure, la Réserve fédérale indique clairement qu’elle va mettre fin à sa politique monétaire non conventionnelle (quantitative easing) et les tensions géopolitiques s’intensifient notamment en raison de la situation en Ukraine.
Les experts et les analystes, selon leur grille de lecture, mettent l’accent sur l’un ou l’autre facteur pour expliquer le début de la baisse du pétrole. Pour une grande majorité d’entre eux, l’élément déclencheur de la chute a été la prise de conscience d’un déséquilibre grandissant sur le marché, entre une offre surabondante et une demande stagnante. Un déséquilibre appelé à durer, selon des analystes de la banque américaine Citi.
Certains observateurs avaient tiré la sonnette d’alarme depuis plusieurs mois. En février 2014, l’agence internationale de l’énergie balayait leurs avertissements. « Des prévisionnistes et des observateurs du marché ont averti depuis des mois d'une surabondance de pétrole et d'une prochaine chute des prix, relevait-elle alors. Au contraire, les prix se sont entêtés à rester élevés », signe de la persistance de tensions sur l'offre, ajoutait-elle. Elle annonçait le besoin de nouveaux investissements, estimés à 900 milliards de dollars par an, et une hausse de la production pour répondre à une consommation mondiale de 92 millions de barils par jour, alors que les stocks de réserve étaient au plus bas.
La suite a donné raison aux pessimistes. Pour eux, rien ne justifiait que les cours du pétrole restent imperturbablement depuis 2009 au-dessus de 100 dollars le baril alors que tous les signes d’un dérèglement du marché étaient déjà visibles.
Côté offre, le marché a agi durant des années comme si l’apparition de nouveaux pays producteurs comme le Brésil – 2,3 millions de barils par jour –, l’exploitation de nouveaux gisements offshore, le boom de la production de l’huile de schiste et des sables bitumeux – plus de 4 millions de barils par jour aux États-Unis – étaient sans grande conséquence. Leur arrivée, d’après certains observateurs, compensait tout juste l’effacement, momentané ou durable, des productions de l’Irak ou de la Libye. Mais les anciens pays producteurs qui avaient disparu sont revenus sur les marchés : les problèmes de guerre et sécurité qui avaient empêché l’écoulement de leur production ne semblent plus insurmontables. Les autres ont accéléré la vente de leur pétrole, tandis que de nouveaux gisements ont été mis en exploitation à des vitesses inattendues partout dans le monde, tous les projets semblant viables grâce aux prix stratosphériques du brut. Résultat : la production a augmenté bien plus vite que prévu : elle a crû de 3 millions de barils par jour en 2013 et encore en 2014. L'OPEP évalue le surplus d'offre à deux millions de barils par jour.
Dans le même temps, le rythme de croissance de la consommation mondiale a sérieusement ralenti. Marqués par l’envolée historique de la Chine depuis le début des années 2000, les observateurs ont poursuivi les courbes ascensionnelles de la consommation pétrolière. La demande chinoise devait continuer à croître de 6 à 7 % par an. Les pays émergents devaient suivre sa trace. Les pays occidentaux devaient se relever de la crise, renouer avec la croissance et recommencer à augmenter leur consommation pétrolière.
Mais rien ne s’est passé comme prévu en 2014. La croissance mondiale, tant attendue, n’a pas été au rendez-vous. L’économie européenne a continué à stagner. La Chine, après avoir tenté de masquer pendant des mois sa situation, a dû reconnaître au début de 2014 un certain essoufflement, après des années de croissance dopée au crédit et aux surinvestissements. Les pays émergents ont été touchés à leur tour par le désordre international. La demande a fait du surplace.
À ces éléments conjoncturels s’ajoutent des changements structurels. Même si elles devraient être beaucoup plus importantes, les économies d’énergie sont devenues une réalité dans les pays occidentaux et en particulier en Europe, ce qui limite l’augmentation de la demande. De plus, le pétrole subit désormais la concurrence directe du gaz. Au vu des prix astronomiques du pétrole, de nombreux industriels ont choisi de se reporter sur le gaz. Depuis les années 1980, la consommation de gaz a été multipliée par trois, quand celle de pétrole a seulement doublé. Le phénomène de substitution s’est encore accéléré ces dernières années avec l’apparition du gaz de schiste, qui a entraîné un effondrement des cours. Il n’y a pratiquement plus aucune centrale électrique fonctionnant au fuel aux États-Unis. De même, quand le Japon a dû chercher une alternative pour produire de l’électricité, à la suite de l’accident de Fukushima, il s’est tourné vers le gaz.
Ce mouvement de substitution est appelé à s’intensifier, d’après les prévisions d’Exxon Mobil. Le groupe pétrolier prévoit que le pétrole, qui a pris la place du charbon au tournant des années 1950, va à son tour être évincé par le gaz. Ce dernier pourrait représenter près du tiers de la consommation d’énergie mondiale dans les décennies 2020-2030. De son côté, Total anticipe une hausse de 45 % de la consommation de gaz dans les vingt prochaines années.
Les marchés ont choisi délibérément d’ignorer tous ces facteurs, persuadés que les cours du pétrole étaient voués à rester accrochés au-dessus de 100 dollars le baril. Ils étaient d’autant plus convaincus de la stabilité de la situation qu’ils pensaient que l’Arabie saoudite aurait la capacité, comme elle le fait depuis plus de quarante ans, de remettre les choses en ordre sur le marché pétrolier, si d’aventure celui-ci plongeait. Les espoirs ont été douchés.
Que cherche l’Arabie saoudite ?
La réunion de l’OPEP du 27 novembre 2014 a provoqué un séisme dans le monde pétrolier : le cartel a changé de politique. Pour la première fois depuis 1973, il a décidé de sacrifier ses revenus et d’accepter des baisses de prix plutôt que de limiter sa production. L’Arabie saoudite a été le chef d’orchestre de ce changement, imposant ses vues aux onze autres pays producteurs du cartel.
Depuis 1945, Riyad est le bras armé des États-Unis en matière de politique pétrolière mondiale, le pétrole n’ayant jamais cessé d’être une arme géopolitique depuis le début du XXe siècle. Représentant 10 % de la production mondiale, il est le grand régulateur des marchés pétroliers, assurant le maintien des approvisionnements et des prix, par sa seule décision d’augmenter ou de diminuer sa production. Impossible pour certains observateurs que l’Arabie saoudite ait décidé seule, sans l’assentiment des États-Unis, de maintenir sa production et de précipiter la chute du pétrole. L’Arabie saoudite s’était déjà prêtée à ce jeu en 1985, amenant le prix du pétrole à 10 dollars. Cet effondrement avait contribué à asphyxier financièrement l’URSS, déjà bien mal en point, et avait conduit à son écroulement. Selon eux, c’est le même scénario qui se reproduit. La décision saoudienne s’inscrit dans le jeu géostratégique américain, destiné à amener à résipiscence la Russie, l’Iran, le Venezuela et tous les autres pays récalcitrants (voir notre article Pourquoi le pétrole est redevenu une arme géopolitique). Une analyse que récuse totalement le prince saoudien Alwalid bin Talad dans un entretien à USA today. «L'Arabie saoudite et le Russie sont dans le même lit. Les deux sont touchées en même temps», soutient-il
L’Arabie saoudite tient, en tout cas, un discours bien éloigné des supposés intérêts américains. Alors que l’OPEP ne représente plus que 35 % du marché mondial pétrolier, Riyad semble ne plus être d’accord pour porter à lui seul les efforts pour assurer la stabilité du marché. Interrogé, au lendemain de la réunion de l’OPEP, sur sa décision de ne pas réduire sa production pour garantir les 100 dollars le baril, le ministre du pétrole, Ali al-Naimi, répliquait : « Pourquoi l’Arabie saoudite réduirait-elle sa production ? Les États-Unis sont aussi un grand producteur maintenant. Réduiront-ils la leur ? ». La même question avait été posée avant la réunion à la Russie – non membre de l'OPEP – qui elle aussi avait refusé de participer aux efforts de stabilisation du marché, en diminuant sa production. Un chiffre paraît avoir particulièrement fait réfléchir Riyad : désormais les importations pétrolières américaines en provenance du Canada sont supérieures à celles venues d’Arabie saoudite.
La nouvelle ligne officielle de Riyad est désormais de laisser faire le marché. Le ministre saoudien du pétrole s’interroge même publiquement sur l’avenir de l’OPEP. « Une réunion par an est largement suffisante », a-t-il déclaré, laissant entendre que le cartel pétrolier n’avait plus vraiment d’objet.
Au jeu du marché, l’Arabie saoudite est assurée d’être gagnante, au moins à court et à moyen terme : elle a les plus grandes réserves et les plus bas coûts de production. Selon les chiffres du monde pétrolier, le prix d’équilibre du baril est autour de 20 dollars en Arabie saoudite, entre 30 et 35 dollars en Russie, entre 60 et 70 dollars pour les gisements en eaux profondes, autour de 60 à 80 dollars pour les huiles de schiste aux États-Unis, et à 100 dollars pour les sables bitumineux.
Cette volonté de faire le ménage sur le marché pétrolier et de maintenir ses parts de marché n’a pas été démentie par la suite. Ces derniers mois, l'Arabie saoudite a consenti des ristournes non négligeables à ses clients asiatiques pour les conserver. Le 5 janvier, elle a annoncé qu’elle diminuerait ces remises pour les prochaines livraisons, compte tenu de la baisse des cours pétroliers, rapporte l’agence Bloomberg. Le même jour, elle a fait des offres avec des rabais importants pour des clients américains, dans l’espoir de restaurer ses parts de marché aux États-Unis.
L’ombre pesante de la finance sur le marché pétrolier
« Comme nous l’avons appris à nouveau dans la foulée de la "grande crise financière", la finance et la macroéconomie sont liées de manière inextricable. Dans la phase historique actuelle, les marchés réels et les marchés financiers sont également très fortement intégrés à l’échelle globale, comme ils le furent de manière presque ininterrompue pendant de nombreuses décennies jusqu’à la Grande Dépression », constate Claudio Borio, directeur de la banque des règlements internationaux (BRI), dans un de ses récents travaux sur les conséquences de la financiarisation de l’économie (voir notre article La crise et le cycle financier: un renversement de perspective).
Cet avertissement vaut plus particulièrement pour les marchés pétroliers. La finance est la grande oubliée dans les nombreuses explications sur la chute du pétrole. Elle est pourtant un acteur de premier plan, au point que certains se demandent si elle n’est pas à l’origine de l’effondrement actuel. Pour eux, les prix du pétrole sont largement manipulés depuis des années. Ce à quoi nous assistons, selon eux, c’est bien davantage à l’éclatement d’une bulle spéculative sur le pétrole (et sur les autres matières premières d’ailleurs, le cuivre, le minerai de fer, l’acier chutant eux aussi depuis juillet 2014, même si c’est dans des proportions moindres) qu’à la prise de conscience subite d’une offre surcapacitaire sur le marché pétrolier. Tout se brouille en juillet 2014, expliquent-ils, car à cette date la Réserve fédérale annonce la fin de la politique non conventionnelle (quantitative easing). Le robinet à milliards de dollars qui se déversait chaque mois dans les poches des acteurs financiers va se fermer. « De nombreux investisseurs se préparent à se ruer vers la sortie, parce qu’ils savent que les prix des actifs financiers sont sans rapport avec les fondamentaux », écrit Paul Hodges d’International eChem.
Depuis le début des années 2000, le marché pétrolier est devenu un des terrains de jeu favoris du monde financier. Il a soutenu, accompagné, encouragé l’explosion du cours de l’or noir, parvenu à plus de 150 dollars en juillet 2008. À l’époque, Goldman Sachs prédisait que les prix atteindraient 200 dollars le baril dans l’année. L’appétit vorace de la Chine pour les matières premières en général, le pétrole en particulier, justifiait, à leurs yeux, tous les paris sur l’avenir.
Après la crise financière de 2008, la spéculation sur le pétrole a repris de plus belle, alimentée par l’argent des banques centrales. Une partie des 4 000 milliards de dollars déversés par la Réserve fédérale, et captés essentiellement par la finance, est venue se placer sur le marché pétrolier, censé être une place sûre. Alors que le marché pétrolier était auparavant dominé par les données physiques entre l’offre et la demande, ces dernières ont été totalement balayées par les marchés financiers. En 2005, les échanges financiers sur le marché pétrolier représentaient déjà 3 fois le marché physique. En 2013, ils s’élevaient à plus de 8 fois...
Des milliers d’instruments financiers dérivés ont été créés pour soutenir cette spéculation. Là encore, on parle en centaines de milliards de dollars. Le pétrole papier a servi de support à des opérations financières, en garantie de crédit passant dans de nombreuses mains. Aujourd’hui, personne ne connaît précisément l’ampleur de cette montagne d’engagements, de contreparties. Nous sommes à nouveau devant un continent financier immergé.
Les producteurs pétroliers, grands et petits, ont trouvé guichets ouverts auprès des financiers pour soutenir de nouveaux projets d’exploitation et d’investissements. Gisements en eaux profondes, exploitation de sables bitumeux au fin fond de l’Alberta, exploitation d’huile de schiste dans le Dakota du Nord, prospection dans l’Arctique : tout intéressait le monde financier. Quand les taux de crédit sont à zéro et le baril à plus de 100 dollars, la question de la rentabilité devient annexe.
Tous les grands groupes pétroliers internationaux ont pu lancer des projets d’exploitation gigantesques, sans le moindre souci d’argent. Pétrobras, le groupe pétrolier brésilien, a vu les banques se précipiter pour l’aider à exploiter un gigantesque gisement en eau très profonde (plus de 3 000 mètres). Le groupe russe Rosneft a pu contracter une dette de 45 milliards de dollars auprès des banques internationales pour racheter son concurrent TNK. (L’arrivée à échéance d’un emprunt de 21 milliards de dollars à la fin d’année 2014, que le groupe pétrolier ne semblait pas pouvoir honorer en raison des sanctions, a été une des raisons qui a précipité l’écroulement du rouble à la fin de l’année 2014, obligeant la banque centrale russe à intervenir.) Les petites sociétés d’exploitation d’huile de schiste, qui ont fleuri par centaines ces dernières années aux États-Unis, ont trouvé les mêmes facilités auprès des marchés. Cette explosion a été financée à coups de dettes.
En quelques semaines, cet eldorado s’est écroulé. Avec leur rationalité légendaire, si bien décrite par André Orléan, les financiers sont passés de l’euphorie à la panique. Tout ce qui touche le pétrole paraît leur brûler les doigts. En silence, les financiers sont en train de liquider aussi vite que possible les engagements pris dans le secteur pétrolier et qui leur paraissent désormais à haut risque.
Les traders qui pariaient sur une baisse momentanée du pétrole, ont changé d’avis depuis le début de l’année. Pour eux, il n’y a rien à attendre de l’Europe. Quant à la Chine, elle est devenue un océan d’incertitudes. Ils ne croient plus à un rebond possible de l’économie mondiale, et donc du pétrole, avant de longs mois. Ils amplifient encore la chute par leurs paris sur l’avenir. Les contrats pour livraison en mars se prennent en dessous de 30 dollars, ceux pour livraison en juin à 20 dollars sur le marché pétrolier de New York (Nymex). Une fois encore, la finance l’emporte sur le marché : les paris pris représentent déjà 1,7 fois le marché physique, relève le site boursier MarketWatch. Jusqu’alors, les autres marchés étaient restés à l’écart de la tourmente pétrolière. Mais la contagion gagne. Les marchés d’actions et obligataires sont à leur tour pris dans ce désordre.
Les pays producteurs peuvent-ils soutenir longtemps cette guerre des prix ?
La chute brutale des cours du pétrole fait déjà des dégâts considérables dans les pays producteurs. Frappée par ailleurs par des sanctions, la Russie paie au prix fort le fait d’avoir une économie totalement dépendante du pétrole et des matières premières. Le rouble a décroché au même rythme que les cours pétroliers. En six mois, il a perdu plus de 40 % de sa valeur face au dollar, obligeant la banque centrale à intervenir massivement pour soutenir la monnaie, les banques et les grands groupes russes. Un plan de 1 000 milliards de dollars est prévu pour aider le système financier, les groupes russes endettés jusqu’au cou en monnaies étrangères, en dollars de préférence. Selon les premières estimations de la banque centrale, l’économie russe devrait connaître une récession de l’ordre de 5 % cette année (voir notre article Russie, Venezuela, Algérie sont frappés de plein fouet par la chute du prix du pétrole).
Le Venezuela, quant à lui, est au bord de l’explosion. Pour les observateurs, ce n’est plus qu’une question de semaines avant qu’il ne s’écroule. Dans une tentative désespérée, son président Nicolas Maduro s’est rendu en début de semaine dernière en Chine, dans l’espoir d’obtenir quelque aide (voir notre article Nicolas Maduro ou la fin de l’ère chaviste).
Mais le malaise s’étend. Le Nigeria, déjà en état de déliquescence, est au bord de l’asphyxie, au fur et à mesure que les cours s’écroulent : ses seuls revenus sont liés à la rente pétrolière. L’Angola est lui aussi très ébranlé. Au-delà des chutes des économies qui semblent inévitables, les observateurs s’inquiètent de nouveaux risques de déstabilisation sur le continent africain, si la situation devait se prolonger.
Le gouvernement kazakh a déjà averti qu'il fallait se préparer à des lendemains moroses avec un pétrole autour de 40 dollars. Le Canada, dont une grande partie des succès économiques de ces dernières années est liée à l’exploitation minière et pétrolière, commence lui aussi à s’inquiéter. Des États américains producteurs comme le Texas, l’Alaska ou le Dakota du Nord s’alarment alors que les sociétés pétrolières annoncent des réductions massives d’emploi et d’investissement. Même la riche Norvège n’est pas immunisée. Elle aussi très dépendante de la rente pétrolière et gazière, son économie donne des signes de faiblesse. La banque centrale norvégienne a déjà baissé par deux fois ses taux d’intérêts, ces dernières semaines, dans l’espoir de relancer l’activité.
Soit parce qu’ils étaient tenus par des contrats passés, soit parce qu’ils veulent compenser leur baisse de revenus, les producteurs, pour l’instant, n’ont pas du tout diminué leur production. Au contraire. Il n’a jamais été produit autant de pétrole que ces derniers mois. En décembre, la production russe a atteint un niveau inégalé depuis 1991. L’Irak, pour sa part, a produit 2,94 millions de barils par jour en décembre, soit le plus haut niveau depuis 1980. Les États-Unis sont sur la même pente. Leur production a atteint en décembre 9,4 millions de barils par jour, un record depuis 1983.
Les observateurs pensent qu’il faudra du temps avant que la production s’adapte aux nouvelles conditions du marché. Les sociétés pétrolières ont déjà annoncé la division, par deux parfois, de leurs investissements. Les grands projets d’exploration sont repoussés à des jours meilleurs, ou tout simplement enterrés. Mais il y a tous les gisements qui sont en exploitation. Et là personne ne veut ou ne peut lâcher.
C’est particulièrement vrai pour les sociétés d’huile de schiste. Endettées jusqu’au cou, elles sont condamnées à produire pour faire face à leurs échéances financières. Aujourd’hui, elles tentent de tenir en produisant toujours plus, d’autant que le cycle de vie d’un gisement non conventionnel est très court, de l’ordre de trois ans.
Cette fuite en avant peut-elle durer longtemps ? « La capacité de résistance des sociétés pétrolières non conventionnelles, et leur possibilité de produire à bas coût, sont peut-être sous-estimées », pense un expert de Total. « Tout dépendra de l’attitude des financiers. S’ils acceptent ou non de les financer. » Le monde financier, pour l’instant, paraît ne plus vouloir les suivre. Les taux pour le risque crédit de ces sociétés américaines atteint les 1 000 % aux États-Unis. Déjà, certains prédisent une vague de faillites et de concentration sans précédent dans les mois à venir. Ils se demandent si cela ne va pas remettre en cause la politique d'indépendance énergétique des États-Unis, menée depuis près de dix ans.
Le grand nettoyage du marché que semble rechercher l’Arabie saoudite aurait alors bien lieu. Mais Riyad a-t-il lui aussi les moyens de tenir aussi longtemps qu’il veut bien le dire ? C’est une des grandes questions que se posent les acteurs pétroliers. Si l’industrie pétrolière saoudienne peut faire face à des cours de 30 dollars, grâce à ses coûts de production très bas, il y a aussi la question des finances publiques. Compte tenu de ses dépenses d’armement, de ses dépenses sociales et d’équipement, le gouvernement saoudien a besoin d’un pétrole autour de 80 à 90 dollars pour assurer ses rentrées financières. Il a publié son budget pour 2015. Il y est prévu un déficit de 15 milliards de dollars. Une première pour le royaume saoudien, habitué à des excédents massifs. Dans cette situation exceptionnelle, l’Arabie saoudite a les moyens de faire face. Elle est assise sur plus de 750 milliards de dollars de réserves qu’elle compte bien utiliser dans cette guerre des prix.
Cette perspective commence à effrayer certains analystes. Car tous les pays producteurs vont avoir la tentation de rapatrier les excédents pétroliers qu’ils recyclaient sur les marchés financiers, en priorité aux États-Unis. La masse de ces pétrodollars se chiffre en centaines de milliards de dollars. L'exode a déjà commencé, semble-t-il. Selon une étude de BNP Paribas, le montant des excédents tirés du pétrole s'est établi à moins de 60 milliards de dollars en 2014, alors qu'il dépassait les 500 milliards de dollars en 2006. En d'autres termes, les pays producteurs de pétrole retirent plus d'argent qu'ils n'en investissent sur les marchés financiers. Quand une telle masse se met en mouvement, et ne vient plus assurer la liquidité des marchés financiers comme elle l’a fait pendant des années, cela peut engendrer de grandes secousses planétaires.