En 1985, un ouvrage collectif publié aux éditions La Découverte jetait un pavé dans la mare. Sobrement intitulé Les Risques du travail mais agrémenté de ce sous-titre en forme d’avertissement, “Pour ne pas perdre sa vie à la gagner”, il imposait pour la première fois pleinement le sujet dans le débat social. Une question éminemment sensible, qui passe souvent à la trappe face aux enjeux économiques et politiques.
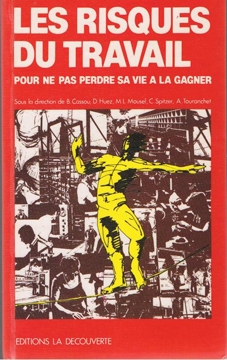 Les Risques du travail 1985 © DR
Les Risques du travail 1985 © DRTrente ans plus tard, alors que le chômage est au plus haut, que des pans entiers du droit du travail sont détricotés au nom de la simplification, l’ouvrage est totalement remis à jour sous la direction de la sociologue du travail Annie Thébaud-Mony, de Philippe Davezies, enseignant-chercheur en médecine et santé au travail, de Laurent Vogel, juriste et chercheur en santé au travail à l’institut syndical européen, et de Serge Volkoff, statisticien et ergonome. Ce sont à nouveau des dizaines d’auteurs qui sont mobilisés au fil des pages : chercheurs, syndicalistes, avocats, juristes, les regards sont multiples et concis et permettent de faire de ce livre un outil scientifique et militant d'envergure.
Sur le constat, trente ans après, c'est toujours alarmant. Mediapart tente un état des lieux avec Annie Thébaud-Mony et Laurent Vogel.
Cet ouvrage arrive trente ans exactement après le premier livre collectif sur les risques au travail. Quel avait été son impact à l’époque ?
Annie Thébaud-Mony. Lors de la première édition, en 1985, le déficit d’informations était vraiment important. Et le livre avait donc pour objectif premier de donner de l’information sur ces risques. Aujourd’hui, on est plutôt dans la situation où il y a une masse d’informations, mais qui proviennent de différentes sources, et où l’on a besoin de les distinguer, les décoder.
Laurent Vogel. Trente ans après, il y a eu beaucoup de transformations dans l’organisation du travail lui-même, les gens font face à des expositions multiples et ne vont plus se reconnaître dans le modèle ancien d’un métier qui débouche sur une maladie, avec le cas typique de la silicose du mineur, évidemment beaucoup plus rare que dans le passé.
Avez-vous l’impression que certains risques sont désormais derrière nous ?
A. T.-M. Dans les systèmes de production de type industriel, l’objectif premier a bien été la réduction des effectifs par l’automatisation. Mais en même temps, cela a aussi permis de diminuer les expositions pour les salariés. En revanche, les fonctions maintenance, nettoyage, gestion des déchets, qui cumulent tous les risques anciens comme le bruit, la saleté, la poussière, les produits chimiques, ont été massivement sous-traitées et confiées à des travailleurs qui sont moins organisés, moins bien informés. Donc on a davantage remodelé la distribution des risques que concouru à les faire disparaître. Très clairement, aujourd’hui, certaines sous-traitances industrielles sont avant tout une sous-traitance du risque.
Comment cela se fait-il que nous ayons si peu d’informations sur la prévalence des expositions dans ces sous-traitances, alors qu’elles concentrent les facteurs pathogènes ?
A. T.-M. Étant ces derniers temps focalisés sur la compétitivité, l’État comme les entreprises sont gênés par ce sujet. Premièrement parce que si l'on veut faire de la prévention, c’est coûteux. Mais aussi parce que c’est irréductible à un équivalent monétaire. Autant on peut négocier des salaires, des avantages, etc., autant la santé, la vie et la mort, ça ne se négocie pas.
On le voit avec le rétropédalage du gouvernement sur le compte pénibilité, tout le monde se réfugie derrière la complexité d’un système. Parce que le contexte économique est compliqué, la santé au travail passe au second plan ?
A. T.-M. Le travail est constamment estimé comme un coût. Et donc toutes ces histoires de simplification, dont on entend parler à longueur de temps, ou de réduction du Code du travail, veulent dire que la notion de droits fondamentaux des travailleurs à la santé au travail est toujours considérée comme une option.
Mais ont-ils déjà été considérés comme prioritaires ?
L. V. Je crois qu’au moment de l’amiante, incontestablement, cette question est arrivée sur le devant de la scène. Ça ne veut pas dire qu’on a trouvé des solutions à l’ensemble des problèmes mais il y a eu, au minimum, une prise de conscience. La visibilité médiatique joue un rôle. Il y a aussi une responsabilité sociale de la part des chercheurs scientifiques, qui sont très forts pour faire des tas de papiers dans un langage hermétique, mais souvent moins forts pour montrer la dimension politique et publique du problème. Cela renvoie également à la manière dont fonctionne la production de la recherche scientifique. Qu’est-ce qui est valorisé ? Sur quoi on met de l’argent ? Par exemple, on finance bien davantage la recherche sur la génétique que sur les expositions professionnelles. Mais c’est sûr, le contexte de la crise ne facilite pas les choses.
A. T.-M. Il faut aussi parler de la répression absolument impitoyable quand les syndicats se mobilisent, notamment dans les entreprises sous-traitantes. Ces syndicalistes sont, dans la sous-traitance de la maintenance, envoyés aux quatre coins de la France et ne peuvent donc plus exercer leur mandat. Quand ils trouvent le moyen de le faire, ils sont mis à la porte. Des syndicalistes dans ces entreprises, j’en connais. Ils vont se saisir de ce bouquin, j’en suis sûr, mais plus ils vont le faire, et plus la répression à leur encontre va être forte.
Si l’on se penche sur des questions contemporaines, quel lien peut-on faire entre le marché de l’emploi tel qu’il est structuré aujourd’hui, avec une augmentation significative de la précarité, et les risques pour la santé ?
L. V. Ce lien est direct et très fort. À partir du moment où l’on est en situation de travail précaire, la possibilité de formuler un projet de vie est diminuée. Et cela a un impact sur l’ensemble des pratiques de santé et pas seulement la santé mentale. On peut voir par exemple une corrélation entre le travail précaire et la consommation du tabac et de l’alcool. Ensuite, les boulots où l’on est le plus exposé seront attribués aux travailleurs précaires en priorité.
Le livre a clairement une dimension internationale. Est-il possible, par exemple, de faire un comparatif à l’échelle européenne en matière de prévention des risques au travail ?
L. V. Beaucoup de problèmes sont communs mais il n’y a pas de pays modèles. Même en Suède, on a des travailleurs précaires qui n’ont pas des conditions de travail vraiment meilleures qu’en Grèce ou au Portugal. Le trait dominant, c’est la montée des inégalités. Au niveau des réponses, c’est différent. Il y a des pays où l’offensive néolibérale est allée beaucoup plus loin, je pense par exemple aux Britanniques, avec une quasi-destruction des logiques de prévention. Ce qui a changé dans la donne européenne, c’est qu’à la fin des années 1980, l'Union européenne a été un facteur d’amélioration des conditions de santé au travail avec par exemple la création d’un droit d’alerte et de retrait. Cette dynamique s’est inversée, notamment avec l’arrivée de José Manuel Barroso à la commission.
Peut-on corréler, toujours au niveau européen, la dégradation de la santé au travail et l’affaiblissement des syndicats, de la médecine du travail et de l’inspection du travail ?
L. V. Oui. Là où il n’y a pas de CHSCT ou leurs équivalents, les situations sont pires qu’ailleurs. L’affaiblissement de l’inspection du travail est bien lié à une aggravation des conditions de santé. Et c’est clair que dans certains secteurs, la construction ou les transports, le fait d’ouvrir le marché à une concurrence inter-européenne a eu des conséquences très négatives en termes de conditions de travail.
Laurent Vogel revient dans cet extrait vidéo sur la forme d’hypocrisie qu'il y a à adopter des réglementations contraignantes en termes de santé au travail (sur l’amiante par exemple), tout en sous-traitant délibérément une partie du risque à l’étranger.
La précarité mène à la question du genre et des inégalités hommes-femmes. Vous faites un lien entre la question du genre et celle de l’aggravation de la santé, et notamment entre stéréotypes de genre et risques professionnels.
A. T.-M. La place qu’occupent les femmes dans la division sociale et sexuelle du travail n’est pas celle des hommes. Massivement, elles sont dans l’emploi précaire, temporaire et connaissent des carrières altérées, hachées. Un tas de mécanismes jouent pour que les femmes soient sur les mauvais versants du précariat. Un peu de textile, un peu de nettoyage, d’industrie… Quand on recherche les expositions, les experts disent “je ne sais pas”. Il n’y a pas d'étude sur les cancers professionnels et les expositions professionnelles cancérogènes dans le nettoyage par exemple. Il existe seulement une thèse de médecine datant des années 2000, qui montre qu’il y a quatorze cancérogènes dans les chariots des immeubles des femmes de ménage ! L’invisibilité est totale. Ces employées interviennent dans les interstices du travail organisé officiel. S’il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle, cela disparaît dans le secteur qu’on appelle interprofessionnel. Cela ne sera jamais recensé comme un accident du travail sur le site de l’entreprise unetelle. Les femmes sont donc dans un processus d’invisibilisation renforcée. Quant au modèle de référence de la création des tableaux de maladies professionnelles et même de leur évolution, c’est le modèle du travail masculin qui prévaut.
Ce que vous soulevez est fondamental. Comment relier la question de la santé à celle de l’égalité hommes-femmes ?
A. T.-M. Cela passe par une synergie pluridisciplinaire dans la recherche. Il faut faire s’asseoir autour d’une table des disciplines qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, en lien avec les collectifs en résistance sur ces questions. Le mouvement pour l’amiante, par exemple. Je travaille depuis longtemps avec le premier collectif ouvrier de femmes sur l’amiante, Amisol, à Clermont-Ferrand. C’est dans cette optique aussi que nous avions créé l’association Henri Pézerat, du nom de la lutte menée à Jussieu et de mon ancien compagnon (qui aboutira à l’interdiction du minéral en 1996, ouvrant droit à la réparation des victimes).
Nous, chercheurs, ne sortons pas indemnes d’un travail de collaboration avec les syndicalistes, les travailleurs. Quand on a commencé ce travail-là, au début des années 1980, il y avait une grande distance entre chercheurs et syndicats. Henri ne soupçonnait pas le degré de désinformation et de mensonge dans lequel évoluaient les salariées. Il a réalisé l’ignorance délibérément construite de la part du patron et du médecin du travail. Quand une fille était malade, c’était parce qu’elle fumait, qu’elle était obèse, qu’elle avait la tuberculose. Il a donc fallu expliquer l’amiante puis compter les morts. Les travailleurs ne sont pas des données. Ce sont des hommes et des femmes qui vont mourir.
N’y a-t-il pas une responsabilité de l’État à laisser la santé d’une partie extrêmement importante des salariés, notamment dans le secteur industriel, se dégrader ?
A. T.-M. Tout à fait. C’est pour cela que nous travaillons à une inscription du risque industriel en crime social et environnemental dans le code pénal. Le procès de France Télécom sur les suicides va s’ouvrir, et comme le dit l’avocat des victimes Jean-Paul Teissonnière [qui intervient dans ce livre - ndlr], c’est un crime sans produit toxique, mais bien un crime organisationnel délibéré. Il y a une organisation du travail qui visait à la destruction psychologique des salariés pour les contraindre à démissionner. C’est monstrueux.
Le suicide au travail est une réalité dont l'exemple de France Télécom devenu Orange est l'illustration extrême. Des juges ont clos l’enquête sur cette vague de suicides qui vaut à son ex-patron Didier Lombard et à l’ancien opérateur public des télécoms d’être mis en examen pour harcèlement moral. Le procès est attendu pour la fin 2016. Il est suivi de très près par syndicats et spécialistes du droit du travail tant il est susceptible d’ouvrir la voie à la reconnaissance par la justice d’un harcèlement moral organisationnel, contrairement aux cas ordinaires où le lien est direct entre l’auteur présumé et sa victime. Annie Thébaud-Mony revient sur ce procès historique dans cet extrait vidéo.
Êtes-vous consultée par les autorités autour de ces questions de risques au travail ?
A. T.-M. Malheureusement, non. L’autorité de sûreté organise des groupes de travail sur la sous-traitance dans le nucléaire mais EDF a opposé son veto à ma présence. Je suis “blacklistée”. Quand il y a eu une expertise collective sur l’amiante, j’étais la seule chercheuse en santé publique à travailler sur la question de l’invisibilité des maladies professionnelles liées à l’amiante et Henri Pézerat était le seul chercheur en recherche fondamentale à travailler sur la toxicité de l’amiante et ni l’un ni l’autre n’avons été sollicités. Nous étions “trop engagés”. Mais les autres acteurs qui participent au comité permanent amiante créé par le patronat, ne sont-ils pas engagés aux côtés des industriels ?
Parmi les sujets que ce livre aborde, il y a l'épuisement professionnel, plus connu sous son appellation anglaise burn-out. Choc émotionnel, physique et mental, le burn-out est devenu un concept fourre-tout très médiatique. Or, il renvoie à une tout autre réalité de souffrance étudiée depuis quarante ans par de nombreux chercheurs mais qui ne figure pas, pour l'heure, au tableau des maladies professionnelles. Plaidez-vous pour sa reconnaissance ?
A. T.-M. L’épuisement professionnel a pris des formes différentes au cours de l’histoire. Toute une psychologie au service du patronat s’est développée sur les méthodes de management ces trente dernières années. Chasse aux temps morts, intensification, comment faire en moins de temps et avec moins de personnes, management par objectifs... Cela a donné lieu aux troubles musculo-squelettiques tout comme à l’épuisement professionnel, d’autant qu’on a transformé l’obligation du travail en une obligation de résultats. Sur la question de la reconnaissance, ma position est de saisir l’épuisement professionnel comme accident du travail car un accident qui survient sur les lieux ou à l’occasion du travail n’exige pas de prouver un lien de causalité avec le travail.
Car le grand problème de l’épuisement professionnel, c’est la difficulté de la preuve...
A. T.-M. Chaque fois qu’on peut se saisir d’une manifestation sur les lieux du travail de l’accident, on neutralise le problème de la preuve. Aux autres de démontrer que vous n’êtes pas en accident du travail. J’aimerais que cette méthodologie soit davantage connue des syndicalistes. Si le salarié est arrêté, il faut que le médecin fasse un certificat professionnel qui accumule les éléments montrant que l’épuisement professionnel est associé à un certain nombre de symptômes avec des témoignages. La maladie professionnelle est un travail de construction d’un argumentaire qui doit être irréfutable.
Pour agir sur les risques, les syndicats ont-ils une carte à jouer ?
L. V. Je crois que c’est même l’occasion d’un renouveau social important. On ne peut pas aborder les questions de santé au travail sans avoir en interne un fonctionnement plus démocratique. Pour les traiter, les syndicalistes sont tenus de faire émerger cette parole chez les salariés. Et un syndicat ne sort jamais indemne d’une bataille sur la santé au travail.
A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : JACK avec Pulseaudio
