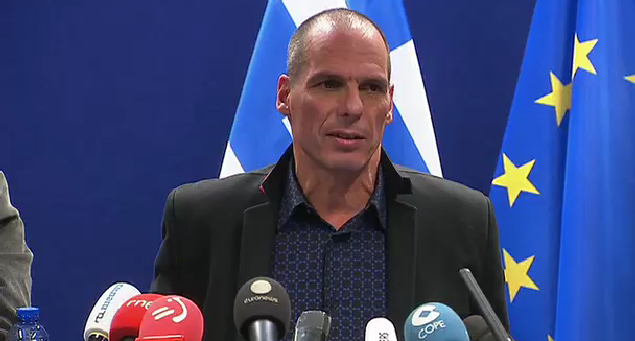Cela devrait déclencher un séisme dans les milieux financiers français mais aussi dans les cercles dirigeants de la « Sarkozie » : le juge Roger Le Loire a pris une ordonnance renvoyant devant un tribunal correctionnel François Pérol, le président de la banque BPCE et ex-secrétaire général adjoint de l’Élysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, pour y être jugé pour « prise illégale d’intérêt ». C’est l’AFP qui le confirme ce jeudi 5 février, en faisant état de sources concordantes.
De nombreux indices suggéraient en effet que le magistrat qui a conduit l’instruction prendrait cette décision : en particulier, le Parquet national financier (PNF) a pris, dès le 7 novembre 2014, des réquisitions en ce sens (lire Affaire Pérol : vers un procès pour prise illégale d’intérêt).
Pressentant que ce nouveau rebondissement judiciaire était imminent, nous avions consacré à la fin du mois de décembre dernier une très longue enquête à l’affaire Pérol, en trois volets, nourrie des nombreux éléments nouveaux que l’enquête judiciaire a mis au jour – enquête dont Mediapart a pu prendre connaissance des principales révélations.
Voici, pour mémoire, les principales révélations de notre enquête.
Dans le premier volet de note enquête, nous révélions d’abord à quel point l’instruction du juge Roger Le Loire avait tranché avec l’enquête préliminaire ouverte suite aux plaintes déposées par les syndicats CGT et Sud des Caisses d’épargne, quand François Pérol avait quitté l’Élysée pour prendre, au début de 2009, la présidence des Caisses d’épargne et des Banques populaires, puis la présidence de BPCE, la banque née de la fusion des deux précédents établissements. À l’époque, on était encore sous la présidence de Nicolas Sarkozy et la procédure avait été pour le moins expéditive.
En droit, il s’agissait d’établir si François Pérol s’était borné à avoir des contacts avec les différents responsables de ces établissements, pour éclairer les choix du président de la République, ou si, outrepassant cette fonction, il avait contribué à peser sur l’avenir de ces deux banques, en organisant lui-même leur mariage, pour ensuite prendre la présidence de la banque unifiée.
En clair, il s’agissait d’établir si François Pérol avait lui-même exercé l’autorité publique sur ces deux banques, avant d’en prendre la direction, ce que les articles 432-12 et 432-13 du Code pénal prohibent : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
Or, l’enquête préliminaire s’est déroulée dans des conditions scandaleuses. À l’époque, un seul témoin a été entendu, François Pérol, comme si cela suffisait à la manifestation de la vérité. Et lors de son audition, le 8 avril 2009, devant la brigade financière – audition dont nous avons pu prendre connaissance –, François Pérol a pu expliquer sans être contredit qu’il s’était borné à éclairer les choix de Nicolas Sarkozy, sans jamais être impliqué dans la moindre décision. Ce qui a donné lieu à ces échanges étonnants :
« Avez-vous eu, en tant que secrétaire général adjoint de la présidence de la République, à suivre le rapprochement des deux groupes et/ou l'apport de 5 milliards d'euros par l'État ? lui demande le policier de la Brigade financière.
— Le rapprochement a été annoncé en octobre 2008, j'en ai été informé de même que les autorités de régulation et de contrôle, par les deux présidents de l'époque, Messieurs Milhaud [le président de l’époque des Caisses d’épargne] et Dupont [le président de l’époque des Banques populaires], la veille ou le jour de l'annonce officielle. J'en ai informé le président de la République. Dans le contexte de crise, ce que les autorités de régulation ont dit aux deux groupes, c'est qu'il fallait aller vite pour exécuter cette opération et que les discussions soient menées rapidement, répond François Pérol.
— Aviez-vous une mission de surveillance ou de contrôle sur ces deux entreprises ou leurs filiales ? insiste le policier.
— Non, répond le banquier.
— Avez-vous eu à proposer directement aux autorités compétentes des décisions relatives à ces entreprises, en particulier dans leur rapprochement et/ou à propos de l'apport de 5 milliards par I'État ?
— Non.
— Avez-vous formulé un ou des avis aux autorités compétentes sur des décisions relatives à ces entreprises, en particulier dans leur rapprochement et/ou à propos de l 'apport de 5 milliards par I'État.
— Non. Mes avis sont destinés au président de la République et au secrétaire général de la présidence. »
Le dialogue a ainsi duré quelque temps, sans que François Pérol n’en dise plus. Et peu de temps après, sans qu’aucun autre témoin ne soit entendu, sans qu’aucune perquisition ne soit conduite pour trouver les documents concernant l’affaire, l’affaire avait été classée sans suite par le parquet… Le patron de BPCE n’aurait donc jamais été rattrapé par la justice si les deux syndicats, ne se décourageant pas, n’avaient pas de nouveau déposé plainte, cette fois avec constitution de partie civile, ce qui a conduit à ce qu’un juge indépendant, Roger Le Loire, soit chargé du dossier Pérol.
L’enquête préliminaire s’est même passée dans des conditions encore plus scandaleuses que cela, car certains des acteurs de l’histoire ont secrètement eu connaissance de certaines de ces pièces, alors qu’elles sont théoriquement inaccessibles quand il n’y a pas de parties civiles. Ces fuites suspectes, c’est, ultérieurement, l’enquête du juge Le Loire qui les a fait apparaître.
Entendu dans le cadre de cette instruction le 12 décembre 2013 par un officier de la brigade centrale de lutte contre la corruption, Bernard Comolet – qui avait pris brièvement la présidence des Caisses d’épargne lors de la chute de Charles Milhaud avant d’être évincé à son tour par François Pérol – a été interrogé sur la présence d’un CD-Rom trouvé à son domicile, à l’occasion d’une perquisition réalisée le matin même. Car dans ce CD-Rom, les policiers ont retrouvé « des pièces de procédures relatives à l’enquête en préliminaire sur la nomination du président du groupe BPCE ».
Prié de dire comment il était entré en possession de ce document, Bernard Comolet a répondu : « J’avais demandé à l’un des avocats de la Caisse d’épargne d’Île-de-France s’il savait où en était la procédure à l’encontre de François Pérol. En réponse à cette demande, il m’a fourni ce CD en me disant que j’y trouverais les éléments de réponse. Je m’intéressais à cette procédure car je m’attendais à être entendu. »
Dans ce deuxième volet de notre enquête, nous révélions que la justice avait mis la main, lors de l’instruction, sur des courriers anonymes retraçant des échanges d’e-mails sur une très longue période, entre de très nombreux protagonistes de notre histoire. À Mediapart, nous avions aussi été informés de l’existence de ces mails, mais ne sachant pas dans un premier temps comment la justice allait les apprécier, nous n’en avions fait qu’une brève mention à l’occasion de l’une de nos enquêtes dès le 31 janvier 2011 (lire La justice va décider si l’affaire Pérol sera ou non étouffée).
Or, ces mails – tantôt cocasses, tantôt stupéfiants – figurent bel et bien dans le dossier d’instruction du juge Roger Le Loire, qui s’est appliqué à vérifier s’ils confirmaient ou non l’implication directe de François Pérol dans les dossiers des Caisses d’épargne et des Banques populaires. Ce sont même ces mails qui ont visiblement servi au magistrat de fil conducteur pour conduire ses investigations, et lui permettre d’arriver à la conviction que François Pérol ne s’est pas borné à éclairer Nicolas Sarkozy sur les décisions qu’il devait prendre, mais qu’il a réellement exercé l’autorité publique sur les deux banques dont il a pris ultérieurement la présidence. Ces mails ont aussi souvent servi de trame à la police judiciaire pour conduire les auditions de témoin voulues par le magistrat. Et, dans la foulée, ce sont ces mêmes mails qui éclairent sous un jour cru les ressorts du fonctionnement du capitalisme parisien.
Une bonne partie de ces mails ont pour émetteur ou pour destinataire un avocat, Me François Sureau, qui joue dans cette histoire des Caisses d’épargne et de l’affaire Pérol un rôle singulier. Avocat des Caisses d’épargne du temps de Charles Milhaud, il est ensuite devenu l’avocat de François Pérol.
Dans ce volet de notre enquête, nous avons donc présenté les mails qui sont entre les mains de la justice et qui suggèrent une implication directe de François Pérol dans les dossiers des Caisses d’épargne, dès 2002 et jusqu’en 2007. Puis, à partir de 2007, de nouveaux mails viennent éclairer le rôle de François Pérol, qui officie désormais à l’Élysée comme secrétaire général adjoint. Sa mission, telle qu’il la conçoit, est-elle seulement d’éclairer les choix du nouveau président de la République, ou entend-il peser lui-même sur certains choix économiques et exercer l’autorité publique sur certaines banques ? Un premier mail de François Sureau à Charles Milhaud, en date du 29 mai 2007, juste quelques jours donc après la victoire de Nicolas Sarkozy, suggère clairement que la seconde hypothèse est la bonne. Dans ce mail, l’avocat raconte en effet qu’il vient de rencontrer longuement François Pérol et que ce dernier semble disposé à apporter son appui à une très grande opération engageant l’avenir des Caisses d’épargne, opération qui pourrait aller jusqu’à une « démutualisation totale ou partielle ». Ce mail est le seul que nous avions dans le passé déjà évoqué (lire La justice va décider si l’affaire Pérol sera ou non étouffée) et c’est sans doute, pour François Pérol, l’un des plus embarrassants.
Dans le troisième et dernier volet de notre enquête, nous nous attardions sur les révélations faites, lors de l’instruction judiciaire, par Bernard Comolet, l’éphémère patron des Caisses d’épargne, qui prend la présidence de la banque le 19 octobre 2008 quand, sous pression de Nicolas Sarkozy, son prédécesseur Charles Milhaud est poussé vers la sortie après la perte de quelque 750 millions d’euros sur les marchés financiers, et qui restera en fonction jusqu’au 26 février 2009, date à laquelle il est évincé à son tour, pour céder sa place à François Pérol.
Personnage effacé, qui n’a présidé les Caisses d’épargne que quatre mois, et qui n’était visiblement pas préparé à jouer le premier rôle, Bernard Comolet a été visé par une perquisition, à son domicile, le 12 décembre 2013. Et le même jour, il a été longuement entendu par un commandant de la Brigade centrale de lutte contre la corruption.
Cette audition constitue un événement à double titre. Au plan judiciaire d'abord, car le banquier a très précisément expliqué le rôle qu’a joué François Pérol et dans quelles conditions ce dernier a pris le pouvoir au sein de la banque. Événement sociologique aussi car, tantôt candide, tantôt naïf, le banquier a expliqué au policier dans quelles conditions d’autres proches de Nicolas Sarkozy l’avaient pris en main avant même que n’intervienne François Pérol, pour le parrainer dans la vie parisienne des affaires dont il ne connaissait pas les arcanes. D’autres proches, tel Alain Minc, le conseiller de Nicolas Sarkozy et grand entremetteur du capitalisme parisien ; ou encore René Ricol, l’expert-comptable le plus connu dans les milieux du CAC 40, que Nicolas Sarkozy nommera d’abord médiateur du crédit puis commissaire général à l’investissement.
Bernard Comolet raconte d'abord dans quelles conditions il est entré en contact avec Alain Minc – qui était déjà secrètement le conseil de son prédécesseur, Charles Milhaud : « Au sujet d’Alain Minc, rapporte-t-il, je dois vous dire que je suis issu de la banque et de la Caisse d’épargne et que ma nomination en qualité de Président du Directoire de CNCE [il s’agit de la Caisse nationale des caisses d’épargne, l’instance de direction de la banque] m'a projeté dans un monde dont je n'étais pas familier. Je vous précise que hormis mes connaissances de la banque, je ne fais pas partie de la haute administration et que je n'ai pas de réseau. C'est M. René Ricol qui est venu me voir après ma nomination (je le connaissais depuis qu'il avait été commissaire aux comptes de la Caisse d'épargne d’Ile-de-France en 1985) pour me dire qu'il fallait que je rencontre Alain Minc. J'ai donc rencontré une première fois Alain Minc en octobre-novembre 2008 en compagnie de René Ricol et d'Alain Lemaire [à l’époque, l’éphémère numéro 2 des Caisses d’épargne]. À cette occasion M. Minc nous a indiqué que compte tenu de l'ampleur de la tâche (la fusion avec Banques populaires) et de sa complexité, nous aurions besoin d'être conseillés. À ce titre, il accepterait de regarder notre dossier pour se déterminer s'il pouvait accepter d'être notre conseil. À cette occasion, M. Minc nous a indiqué que nous serions bien inspirés de nous choisir maintenant un inspecteur des finances pour nous aider, qu'aujourd'hui, on avait certainement encore le choix du nom mais que dans quelques mois le nom s'imposerait. »
Alain Minc, qui est le conseiller occulte de Nicolas Sarkozy et qui rencontre donc aussi fréquemment son ami François Pérol à l’Élysée, fait-il donc comprendre à Bernard Comolet qu’il aurait tout intérêt à enrôler ce dernier à ses côtés, faute de quoi l’intéressé risque fort de lui prendre sa place de force ? Bernard Comolet ne le précise pas, et poursuit son récit de la manière suivante : « Avec le recul, je décode ces propos ainsi : nous aurions eu bien moins de problèmes avec un inspecteur des finances à nos côtés, lequel aurait été familier dans nos relations avec les pouvoirs publics. »
« À l'issue de cette première rencontre, poursuit le patron par intérim des Caisses d’épargne, un deuxième rendez-vous a été programmé sans que je l'aie sollicité et pour lequel M. Lemaire n'a pas jugé utile de m'accompagner. Au cours de cet entretien, j'ai fait savoir à M. Minc que je n'avais besoin de rien. C'est après cela que j'ai eu la surprise de recevoir le petit mot d'Alain Minc que vous avez saisi, et qui est en fait une lettre de récriminations dans laquelle il se plaint qu'on se prévaudrait de ses services alors qu'il ne nous a point offert ses services. »
En quelque sorte, Bernard Comolet a été pris, si l’on peut dire, en sandwich. D’abord, il a été approché par deux intimes de Nicolas Sarkozy, René Ricol et Alain Minc. Puis, c’est avec un autre proche du même Nicolas Sarkozy qu’il aura affaire, François Pérol. Et cela se passera exactement comme Alain Minc le lui avait par avance suggéré : faute d’avoir appelé à ses côtés un inspecteur des finances, c’est ledit inspecteur des finances qui lui a finalement piqué sa place.
C’est cette seconde partie de l’histoire que Bernard Comolet raconte ensuite au policier, qui l’interroge pour savoir comment il a su que François Pérol serait le futur président de BPCE. « C’est le président de la République lui-même qui me l’a appris et je vais vous dire dans quelles conditions », raconte-t-il.
Bernard Comolet se lance alors dans un long récit, au cours duquel on a tôt fait de comprendre que tout a été organisé à l’Élysée : « Quelques jours avant le samedi 21 février 2009, j'avais été prévenu que François Pérol nous donnait rendez-vous à M. Dupont [le patron des Banques populaires] et à moi, à l’Élysée pour rencontrer le président de la République, ce samedi matin précisément à 11 h 45. À cette occasion le président de la République, Nicolas Sarkozy, nous a indiqué qu'il savait qu'on avait besoin de 5 milliards d’euros et que l’État avait pris la décision de les mettre à notre disposition. À cette réunion il y avait Pérol, Guéant, Dupont, le Président et moi. Le Président est ensuite entré dans les modalités selon lesquelles cette intervention pouvait avoir lieu, c'est-à-dire un prêt convertible en actions dans un délai de 3 à 5 années si des critères fixés dans un MOU (Mémorandum of Understanding) n'étaient pas respectés (conditions de remboursement). Il était précisé par M. Sarkozy que le prêt de 5 milliards d’euros ne serait attribué qu'à l'organe central une fois la fusion Banques populaires et Caisses d’épargne réalisée. »
Et le banquier poursuit : « Le président de la République nous indiquait ensuite, en rappelant que l’État prêtait 5 milliards, qu'il entendait que François Pérol dont il dressait le meilleur tableau, soit proposé comme futur directeur général exécutif du nouvel ensemble. Il nous a indiqué ensuite que le président du nouvel ensemble serait issu des Banques populaires et j'en ai conclu que c'était soit Dupont président du conseil d'administration avec Pérol directeur général, soit Pérol président du directoire et Dupont président du conseil de surveillance. »
En quelque sorte, Bernard Comolet raconte dans quelles conditions il a été prestement débarqué au cours d’une réunion à l’Élysée. Sans que les instances statutaires de la banque n’aient été réunies. Sans que le ministère des finances n’ait été associé en quoi que ce soit à la décision. Le fait du prince, ou un coup de force, comme on voudra…
Visiblement, le chef de l’État a transgressé toutes les procédures et il a congédié le banquier sans même se montrer courtois. « [Nicolas Sarkozy], conclut Bernard Comolet, a indiqué enfin que je devrais traiter avec François Pérol de mon rôle et de ma place dans le futur groupe. Cette annonce était sans appel et m'a été présentée comme une décision. À la fin de cette annonce, le Président s'est excusé du fait de ses occupations et nous a demandé d'en mettre en œuvre les modalités avec François Pérol, dont il disait regretter de devoir se séparer à l’Élysée. Puis il a quitté la salle de réunion. »
En clair, rien ne se passe normalement : Bernard Comolet est démis de ses fonctions, sans que les procédures légales ne soient respectées ; et François Pérol est intronisé patron de la nouvelle entité fusionnée de la même manière.
Et la fin de la réunion se déroule dans des conditions, pour anecdotiques qu’elles soient, qui révèlent les mœurs du capitalisme français de connivence : « La réunion étant dès lors terminée, François Pérol nous a proposé à Philippe Dupont et à moi-même de déjeuner dans un petit restaurant de la rue Gay-Lussac, proche de son domicile. C'était un repas convivial, où il s'est comporté avec moi comme un "patron souriant". Je me souviens qu'on a parlé au déjeuner de mon conseil en communication, conseil que j'ai indiqué ne pas avoir. Selon lui, c'était regrettable, me précisant qu'il avait Anne Méaux, d’Image 7 ; Dupont à son tour précisait avoir Stéphane Fouks, d'Euro-RSCG, comme conseil. »
Bref, l’affaire présente l’immense intérêt de révéler tous les codes du capitalisme de connivence à la française. Un capitalisme qui fait une grande place aux réseaux d’influence et qui tolère d’étranges mélanges des genres entre affaires publiques et intérêt privés, sans que cela ne soit jamais sanctionné.
Mais, pour une fois, la règle de l’impunité risque d’être battue en brèche : renvoyé devant un tribunal correctionnel, François Pérol y sera jugé des chefs de prise illégale d’intérêt. Dans le capitalisme de la barbichette qui est une marque française, c’est un dénouement peu fréquent.
Pour mémoire, on peut aussi se référer ci-dessous à l'« édito vidéo » que Mediapart avait mis en ligne dès le 19 mars 2009, et qui résumait à grands traits pourquoi ce « pantouflage » hors norme faisait débat :
A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : Mac OS X Yosemite récolte vos données en douce