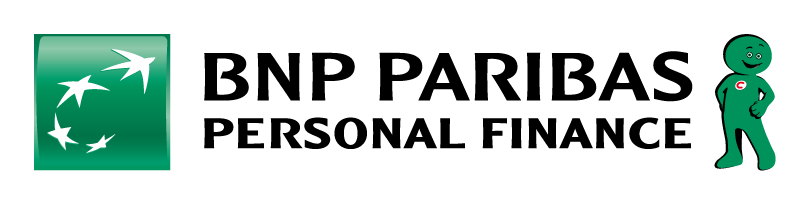Le logement social est à la veille d’un immense « big bang ». Selon nos informations, deux des principaux acteurs du logement social, d’un côté la Société nationale immobilière (SNI), qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, de l’autre, Action Logement, l’organisme paritaire Medef/syndicats qui gère l’ex-1 % Logement, mènent secrètement depuis plus de six mois des négociations en vue d’un rapprochement. Le projet risque-t-il de conduire à une privatisation du logement social, en faisant la part belle au patronat ? Ou bien conduira-t-il à la création d’un immense conglomérat qui jouerait dans le domaine du logement social la fonction qu’occupe l’Unedic dans le domaine de l’assurance chômage : une sorte de nouvelle assurance logement ? La réforme risque en tout cas de susciter de vifs débats, car selon les modalités retenues, c’est l’une ou l’autre des deux solutions qui l’emportera.
Initialement, c’est incontestablement un projet de privatisation du logement social qui a été envisagé entre les dirigeants de la SNI et ceux d’Action sociale. Avant même que le nouveau directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Pierre-René Lemas, n’entre en fonction, l’été dernier, des premiers contacts ont eu lieu entre la direction de la SNI, emmenée par son président André Yché, les dirigeants d’Action Logement (l’organisme paritaire institué en 1952, qui gère la contribution des entreprises, fixée initialement à 1 % de la masse salariale, à l’effort de construction), et le GIC, qui est l’un des principaux organismes collecteurs de ce que l’on appelait donc autrefois le « 1 % Logement ».
Cette synergie d’intérêts a des raisons anciennes. D'abord, le président de la SNI a, de longue date, pour stratégie de rechercher les « plus-values latentes » qu’il peut réaliser grâce au parc social qu’il contrôle, et s’intéresse beaucoup plus au logement intermédiaire qu’au logement social. Au fil des années récentes, la SNI, société publique, s’est donc banalisée, et est devenue un opérateur immobilier qui a copié les règles spéculatives du marché, et s’est éloignée de son ambition fondatrice, celle de l’intérêt général.
De son côté, le patronat milite depuis longtemps en faveur d’une privatisation du logement social. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au Livre blanc pour le logement (on peut le télécharger ici) que le Medef a publié le 9 mars dernier. « Développer la culture de projet en s’appuyant sur le savoir-faire des opérateurs privés » ; « abroger les dispositions les plus contreproductives de la loi ALUR, notamment l’encadrement des loyers » ; « simplifier et raccourcir les procédures à l’encontre des locataires défaillants de mauvaise foi » ; « acquérir les grands fonciers publics de façon massive et à des conditions abordables, via des groupements mixtes associant les promoteurs privés » ; « développer la vente HLM sécurisée aux occupants du parc social » : c’est une dérégulation sociale massive, au profit de promoteurs privés, que propose le Medef, sous les applaudissements du Figaro qui a résumé tout cela d’un titre choc : Logement : le Medef favorable à la possibilité de vendre des HLM.
C’est dans ce contexte de convergences d’intérêts que les premiers contacts ont eu lieu entre la direction de la SNI et les dirigeants patronaux d’Action Logement. Des premiers contacts qui avaient très précisément pour objet d’organiser le retrait de l’opérateur public au profit des opérateurs privés. Mediapart a pu consulter des documents confidentiels qui en attestent. Par exemple, lors de la dernière réunion du comité stratégique de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL – l’organisme de tête d’Action Logement), le 22 janvier dernier, un document y a été soumis, sous l’intitulé « Projet de renforcement du partenariat GIC/SNI ».
On peut consulter ci-dessous quelques-unes des pages de ce document, celles qui résument le projet :
Ce document présente donc le mariage envisagé entre le GIC et la SNI, avec les propositions initiales des deux partenaires. Au début, la SNI a suggéré « de constituer deux structures holding faîtières, l’une intervenant en Île-de-France et l’autre en province ». Et la SNI, qui contrôle ou gère de très nombreuses sociétés HLM en province, proposait d’en offrir les clefs au GIC : « Le GIC aurait vocation à détenir plus de 50 % du capital de la structure faîtière de province, la SNI restant majoritaire dans celle d’Île-de-France », peut-on lire.
De son côté, le GIC présentait trois scénarios possibles. Dans le premier, « le Gic détiendrait 51 % des Entreprises sociales pour l’habitat (ESH) faîtière de province et 49 % de l’ESH faîtière d’Île-de-France, et vice-versa pour la SNI ». Dans le deuxième scénario, « le GIC détiendrait 51 % de l’ESH faîtière d’Île-de-France et 49 % de l’ESH faîtière de province, et vice-versa pour la SNI ». Et dans le troisième scénario, il était envisagé que « le GIC détiendrait 51 % des deux ESH faîtières, tant en province qu’en Île-de-France, et la SNI 49 % ».
Et les dirigeants d’Action Logement ne faisaient pas mystère que ce troisième scénario avait leur préférence. Un scénario conduisant à ce que la SNI, premier bailleur social français, donne les clefs de son parc social à d’autres d’acteurs, dont le Medef. En somme, les dirigeants d’Action Logement préconisaient ce qu’il faut appeler une privatisation du logement social français.
Or, étonnamment, ce projet explosif a visiblement prospéré et la direction de la SNI n’y a pas mis sur-le-champ son veto. Lors d’un conseil d’administration d’Action Logement, le 5 février suivant, les administrateurs ont été informés que les choses évoluaient dans le bon sens : « À l’issue de plusieurs échanges tant avec la SNI que la Caisse des dépôts et consignations, actionnaire majoritaire de la SNI, le projet a significativement évolué », lit-on dans le procès-verbal de la réunion. Sans que l’on sache si la SNI a donné son accord à un contrôle à 51 % des deux structures faîtières en Île-de-France par le GIC, ce n’est plus que cette solution qui est présentée aux administrateurs. Le procès-verbal apporte en effet ces précisions : « Le projet, sur la base des premières estimations financières à parfaire, représenterait un investissement de l’ordre de 460 millions d’euros à mobiliser sur environ cinq années. En contrepartie de cet investissement, le GIC pourrait prendre le contrôle d’un ensemble représentant 185 000 logements dans lequel il est déjà en partie actionnaire minoritaire. »
Cette première mouture du projet aurait pu susciter de vives controverses. D'abord parce que ce montage aurait pour conséquence d’organiser le retrait du principal bailleur social français du secteur du… logement social ! Au moment où le gouvernement ne cesse de répéter que le logement social est pourtant l’une de ses priorités, cela aurait été pour le moins curieux.
En second lieu, dans le passé, une autre filiale de la Caisse des dépôts, Icade, a déjà organisé un immense transfert portant sur quelque 32 000 logements, avec l’aide de la SNI qui avait été l’opérateur de ces cessions. Or, cette opération a été émaillée de fautes graves ou irrégularités, qui ont fini par faire scandale et susciter l’indignation de nombreux élus locaux, dont des élus socialistes. La Cour des comptes va d'ailleurs prochainement publier un rapport à ce sujet.
Mediapart, de son côté, a publié de nombreuses enquêtes, révélant les zones d’ombre de cette sulfureuse opération (lire ici). Alors, organiser un transfert portant non plus sur 32 000 logements mais sur 185 000 logements sociaux, au moment même où le premier scandale va rebondir, voilà qui alimenterait une vive controverse publique.
Il ne semble pas pourtant que le nouveau patron de la Caisse des dépôts et consignations, Pierre-René Lemas, soit disposé à donner son accord à un schéma de rapprochement au terme duquel la SNI perdrait le contrôle sur l’immense parc de logements sociaux qu’elle gère. En clair, le patron de la Caisse semble avoir donné son accord au projet de rapprochement SNI-GIC, mais à des conditions très précises. Primo, il est absolument hors de question que la SNI perde la majorité qu’elle détient dans le capital des sociétés faîtières. Il serait donc envisageable que le GIC monte au capital de ces sociétés, mais sans dépasser la barre des 49 %.
Le nouveau patron de la Caisse considérerait en effet que la SNI peut certes avoir de fortes ambitions dans le secteur du logement intermédiaire, mais qu’elle ne doit pas pour autant oublier sa mission principale, le logement social, ou pis que cela, s’en retirer.
Pour autant, Pierre-René Lemas ne semble pas opposé à ce partenariat avec le GIC. À cela, il y a une raison majeure : la Caisse et sa filiale, la SNI, ont besoin de fonds propres pour investir davantage dans le logement social. La montée en puissance dans des proportions raisonnables du GIC dans les sociétés HLM contrôlées par la SNI pourrait donc fournir ces fonds propres, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires.
Pierre-René Lemas poserait une deuxième condition à ce projet de partenariat. Il souhaiterait que dans les modalités de gouvernance prévues, l’esprit originel du « 1 % Logement », qui reposait sur un système paritaire cogéré par le patronat et les cinq confédérations syndicales, soit méticuleusement respecté. En clair, il s’agirait non pas de faire la part belle au Medef, qui rêve de mettre la main sur le logement social, mais de construire un nouveau système, dans lequel la SNI jouerait un rôle clef. En l'occurrence, construire un immense conglomérat, rassemblant les forces de la Caisse des dépôts et du « 1 % Logement », qui jouerait alors dans le domaine du logement social la fonction qu’occupe l’Unedic dans le domaine de l’assurance chômage : une sorte d'assurance logement.
Mais le projet est hautement périlleux. Car le savant équilibre que semble rechercher le patron de la Caisse n’est pas exempt de dangers. Si la Caisse des dépôts rejette la solution que privilégie actuellement le GIC, les négociations pourraient tourner court. Si en revanche, elle fait trop de concessions, alors la menace d’une privatisation du logement social pourrait être réelle…
Les risques du projet vont même au-delà. Car derrière le paritarisme largement nécrosé de l’ex-« 1 % Logement », c’est le Medef qui a la main. Et la concomitance entre le Livre blanc pour le logement du patronat, et les projets secrets de désengagement de la SNI, est évidemment troublante. Car la SNI, sous la houlette d’André Yché, a toujours trouvé les financements qu’elle voulait pour le logement intermédiaire. Mais au fil des ans, le logement social est devenu le parent pauvre ; et de nombreuses sociétés HLM sous la tutelle de la SNI ont épongé de lourdes pertes à cause de placements hasardeux sur les marchés financiers (lire Des sociétés HLM spéculent toujours sur les marchés). Ceci explique d’ailleurs en partie cela : la SNI est maintenant dans l’obligation d’aller chercher à l’extérieur des financements dont elle ne dispose plus.
Et puis dans ces tractations secrètes que la SNI mène de longue date avec Action Logement, il y a un paramètre qui pourrait expliquer le cheminement un peu chaotique du projet : André Yché, qui ne manque pas d’habileté et entretient des relations confiantes avec le Medef, n’a-t-il pas pensé que l’empire du « 1 % Logement » pourrait être un jour une base de repli, si d’aventure sa bonne étoile à la Caisse des dépôts pâlissait ? L’hypothèse est à prendre d’autant plus au sérieux que l’un des très proches d’André Yché, Bruno Arbouet, va quitter la direction générale d’Adoma (l’ex-Sonacotra, la filiale de la SNI pour le logement très social et les migrants) pour devenir directeur général de l’UESL-Action logement (ici le communiqué l'annonçant). Alors, si la SNI a laissé espérer au Medef qu’il pourrait prendre le contrôle d’une bonne partie du parc du logement social français, n’est-ce pas aussi parce qu’André Yché n’exclut pas un jour d’en prendre la présidence, mais dans un système de gouvernance où la Caisse des dépôts ne jouerait plus les premiers rôles ?
Quoi qu'il en soit, l'affaire de la cession des 32 000 logements d'Icade a déjà fait l'objet, dans le passé, de très vifs débats au sein même des instances dirigeantes de la Caisse des dépôts. À la suite de la publication d'un rapport interne, le président de la commission de surveillance de la Caisse, le socialiste Henri Emmanuelli, avait même établi un relevé de conclusions qui, pour être resté confidentiel, n'en était pas moins très ferme.
Voici ce relevé de conclusions :
Dans ce relevé, daté du 14 mai 2014, Henri Emmanuelli faisait donc ces remarques fortes : « [La Commission de surveillance] relève qu'à l'avenir les objectifs par la logique financière doivent être confrontés aux objectifs de l'exercice d'une activité d'intérêt général et que ces objectifs financiers trouvent leur limite lorsqu'ils entrent en contradiction avec ceux portés par l'intérêt général. Le pilotage resserré des filiales par des objectifs très clairs et fixés en amont constitue l'une des réponses pour limiter d'éventuels conflits d'intérêts. »
On peut donc supposer que la mise en garde qui a été prononcée hier vaut plus que jamais aujourd'hui.
A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : Retour sur l’utilisation de Mumble